Henri Voron
L’huile de palme est aujourd’hui l’huile la plus consommée dans le monde (25%), devant les huiles de soja (24%), colza (12%) et tournesol (7%). Plus de 85% du total mondial sont produits par l’Indonésie et la Malaisie, principalement sur l’île de Bornéo. Mais l’huile de palme est aussi la plus diabolisée, accusée par un certain nombre d’ONG de détruire les forêts tropicales, les sols, la biodiversité, etc…d’exterminer les orangs-outans. De plus on l’accuse d’être mauvaise pour la santé des consommateurs. Qu’est-il exactement ? En termes d’agronomie, en termes de qualité nutritionnelle de cette huile. Quelle appréciation nuancée sur les conséquences écologiques de la récente expansion de la culture du palmier à huile en Asie du Sud-Est ?
1°) Elaeis guineensis : un peu de botanique, d’histoire et de géographie
Comme son nom l’indique le palmier à huile, Elaeis guineensis, pousse naturellement dans le golfe de Guinée. Sous climat équatorial, ou en zone de transition forêt équatoriale épaisse et forêt claire. Il lui faut au moins 1 000 millimètres d’eau par an, ou mieux 1 500 millimètres. La Côte d’Ivoire était le premier producteur mondial d’huile de palme en 1960, année de son indépendance. Mais on en trouvait déjà au Bénin dans les comptoirs français négociés avec le roi de Porto Novo, sous le second Empire. On le trouve un peu partout de la Guinée Conakry au Nigéria en passant par la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, le Togo. Soit en grandes plantations industrielles, soit diffus dans les villages, les cours, les jardins. Son huile rouge, de facture souvent artisanale utilisant des pressoirs manuels, est très appréciée par les populations locales.
L’arbre peut atteindre 20 à 30 mètres de haut. Son « stipe » (qui n’est pas un « tronc » au sens botanique du mot) est formé de la base des feuilles palmées, vert foncé, un peu chiffonnées par rapport à celles du cocotier. Le fruit est une drupe charnue, de forme ovoïde, d’environ 3 cm de long. La pulpe de couleur jaune-orangé, renferme près de 50 % de lipides qui constituent l’huile de palme. Les noix de palme sont groupées en régimes. Un régime pèse entre 5 et 50 kg et contient 500 à 4 000 drupes, selon l’âge du palmier, son origine, et son environnement. Les rendements peuvent atteindre 20 à 30 tonnes de fruit par hectare et par an, et des récoltes de 5 à 8 tonnes d’huile par hectare. Pour une densité d’environ mille palmiers par hectare. Le palmier à huile, comme la canne à sucre, est une formidable machine pour utiliser au mieux la photosynthèse, pour la transformer en aliment, grâce au climat chaud, humide et lumineux.
Cela dit, la Côte d’Ivoire a perdu sa place de championne du monde dans les années 1980 environ, quand la Malaisie et l’Indonésie ont décidé, chacune pour leur part, de lancer la mise en valeur de l’île de Bornéo, très peu habitée à l’époque.
2°) Bornéo, un paradis terrestre presqu’inhabité, à côté de Java, la surpeuplée.
De forme massive, Bornéo est la troisième plus grande île au monde par sa superficie (743 330 km2), derrière le Groenland et la Nouvelle-Guinée. Elle est peuplée d’environ 24 millions d’habitants (densité : 27 hab./km2). La densité de population n’était que de 10 habitants par km² dans les années 1960.
Le territoire de Bornéo est partagé entre trois États souverains : Brunei et la Malaisie au nord, et l’Indonésie au sud :
- Le sultanat de Brunei, situé sur la côte nord, couvre 0,8 % de la superficie des terres de Bornéo (5 765 km2). Le nom de l’île, Bornéo, en est issu par déformation ;
- Les États de Sabah et Sarawak, qui représentent environ 26 % de l’île, appartiennent à la Malaisie pour 200 000 km² environ. Comptant 6,7 millions d’habitants soit 33 habitants au km².
- Le reste de l’île, couvre une surface de 544 660 km2 (73 %) et appartient à l’Indonésie, sous le nom de Kalimantan. Pour une population de 16 millions d’habitants soit une densité de 30 habitants au kilomètre carré. Contre 1 200 habitants au kilomètre carré à Java, l’île la plus densément peuplée du monde.
Bornéo est recouverte en totalité d’un belle forêt équatoriale humide. Et donc un lieu de grande biodiversité végétale et animale, célèbre notamment pour ses orangs-outangs. Le centre est montagneux et culmine à plus de 4 000 mètres d’altitude. Des fleuves en partent en étoile et divise l’ile en compartiments tournés vers la mer, et le plus souvent sans aucun pont pour passer de l’un à l’autre. Le centre de cette grande île reste totalement impénétrable.
3°) Bornéo : le développement des plantations de palmiers à huile
L’Indonésie et la Malaisie ne produisaient ensemble que 5 millions de tonnes en 1976, soit six fois moins qu’en 2016. Ces deux pays restent les plus gros producteurs du monde, avec 85 % du total mondial. Soit 19,2 millions de tonnes pour l’Indonésie et 17,7 millions de tonnes pour la Malaisie. Pour des surfaces estimées respectivement à 4 millions d’hectares en Indonésie et 3 500 000 hectares pour la Malaisie. A ce jour, la production des sept pays les plus producteurs sont estimées dans le tableau ci-dessous :
| Class. | Pays | Production (tonnes) |
| 1 | Indonésie | 19 200 000 |
| 2 | Malaisie | 17 700 000 |
| 3 | Nigeria | 910 000 |
| 4 | Thaïlande | 680 000 |
| 5 | Colombie | 600 000 |
| 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 350 000 |
| 7 | Côte d’Ivoire | 276 000 |
Rapportées à la surface totale des deux parties respectives de l’île, les surfaces plantées en palmiers à huile représentent :
- 35 000 km² sur la partie malaise de l’ile pour une surface totale de 200 000 km² soit 17,5 %
- 40 000 km² sur 544 600 km² pour la partie indonésienne soit un pourcentage de 7 %.
- Pour l’ensemble de l’île de Bornéo le taux de plantations en palmiers à huile est d’environ 10 % (75 000 km² de plantations sur 734 000 km² de surface totale de l’île)
Ce faible pourcentage donne, en creux, un taux de 90 % du territoire, laissé intact pour la forêt équatoriale primaire, sa flore et sa faune. Ou d’autres terres cultivées. Les orangs-outans ont encore de la place…. On est très loin de la « déforestation » calamiteuse dénoncée par la mouvance écologique. Nous y reviendrons.
4°) L’huile de palme : pourquoi un tel succès alimentaire mondial ?
Comme déjà expliqué ci-dessus, cette huile est très populaire, comme huile de cuisine dans les pays tropicaux et équatoriaux concernés, dont la pluviométrie est supérieure à 1 200 mm par an. Elle est abondante, peu couteuse, et issue d’un arbre rustique et sans exigence. Lorsqu’elle est produite de manière artisanale, l’huile brute est rouge presque comme du sang, à cause de sa très haute teneur en vitamine A, ou bien par la molécule dont elle est issue, le carotène. Elle en contiendrait 15 fois plus que la carotte ! Elle renferme aussi des antioxydants de la famille des tocotriénols, une forme de vitamine E qui protège les cellules du cerveau, prévient certains cancers et aide à réduite le cholestérol. Mais ces précieuses vitamines disparaissent lors des traitements industriels destinés à purifier l’huile brute.
Vous chercheriez vainement une bouteille d’huile de palme sur les linéaires de votre distributeur préféré, au côté des huiles de colza, de tournesol, d’olive ou de soja. Car elle est solide, à l’état raffiné, sous nos températures. Elle formerait plutôt un bloc type « margarine ». Vous ne la voyez pas mais elle est présente, à faible dose, dans de nombreux linéaires, notamment ceux de la pâtisserie sèche, biscuits, produits chocolatés, etc… Et elle y est plébiscitée par les producteurs de ces aliments et par leurs consommateurs.
Car « elle fond dans la bouche, pas dans la main » ! Elle possède en effet des qualités physiques et organoleptiques qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs comme l’aspect fondant que l’on retrouve aussi dans le beurre. Elle reste solide à température ambiante, elle se conserve particulièrement bien, elle est stable à la cuisson. Ses propriétés physiques, sa dureté, sa consistance, et sa plasticité lui confèrent une texture onctueuse incomparable. Les enfants l’adorent, et leur marque fétiche est la pâte à tartiner Nutella®, qui n’a pas de concurrent sérieux. Grâce à l’huile de palme qu’elle contient, cette pâte à tartiner est indémodable, sa part de marché est inébranlable. On ne voit pas comment pourrait s’arrêter son prodigieux succès, sur plusieurs générations.
5°) Huile de palme et santé des consommateurs : la mouvance écologique à la manœuvre.
L’huile de palme est évidemment un corps gras, qu’il faut consommer avec modération comme l’alcool, le sucre, le sel. Mais un peu de corps gras ne nuit pas. Il faut aller chercher « la petite bête » ou des histoires de doubles liaisons, d’hydrogénations, d’oméga 3 ou 6 pour critiquer cette huile. Non pas pour protéger les hommes, mais pour sauver la forêt et les orangs-outans. On voit bien la manœuvre : proclamer la soi-disant « toxicité » de l’huile de palme dans un but hautement écologique à Bornéo. Des produits ont été vendus, labelisés « garantis sans huile de palme » par des producteurs ou vendeurs désinformés et par des consommateurs également désinformés par la mouvance écologiste.
Pour contester le caractère prétendument nocif du produit, nous voilà contraint de faire un strict minimum de chimie des acides gras. Ce sont de longues chaines de 15 à 20 atomes de carbones utilisant deux liaisons pour se lier entre eux et deux atomes d’hydrogène pour assure la tétravalence du carbone. D’un coté de la chaine, trois acides gras s’accrochent au glycérol, un alcool assez banal. A l’autre bout, en fin de chaine, on trouve naturellement un CH3. Bref, on est dans le schéma : – CH2 – CH2 – CH2 – …. – CH3. Ceci pour les acides gras dits « saturés » sous-entendu en hydrogène. D’autres acides gras comportent une ou plusieurs doubles liaisons de type CH2 – CH=CH- CH2…. Or ces acides gras insaturés sont des antioxydants, donc a priori meilleurs pour la santé. Les acides gras d’origine animale ne comprennent pratiquement que des acides gras saturés. En revanche, les huiles végétales comprennent des taux variables de « saturés » et « d’insaturés ».
| Acides gras de l’huile de palme | Pourcentage | |
| Saturés | Acide palmitique | 44 % |
| Acide stéarique | 4,5 % | |
| Acide myristique | 1 % | |
| Mono-insaturés | Acide oléique | 38 % |
| Poly-insaturés | Acide linoléique | 10 % |
| Acide linolénique | 0,5 % | |
Ce tableau donne les noms chimiques des différents acides gras, très communs dans notre alimentation. On remarque que l’huile de palme compte à peu près 50 % d’acides gras saturés et 50 % d’acides gras insaturés. Par ailleurs, l’acide oléique qui est celui de l’huile d’olive, est présent à hauteur de 38 % dans l’huile de palme. Or l’huile d’olive est chantée partout, comme l’élément essentiel du régime « crétois » censé prolonger longtemps la durée de vie des personnes adeptes de ce régime. On peut donc affirmer scientifiquement que l’huile de palme est la base, à 38 %, d’un « régime crétois ».
Mais on peut poursuivre la querelle nutritionnelle en parlant des « oméga 3 » et des « oméga 6 ». Ce ne sont pas des produits ou des molécules cachées quelque part. Les chimistes spécialisés dans les acides gras repèrent la position de la double ou des doubles liaisons des acides gras insaturés par rapport à leur « queue », c’est-à-dire la molécule finale en CH3. Lesdits chimistes baptisent « oméga » l’atome de carbone final de la chaine, puis oméga 3 celui qui précède une première double liaison. Et oméga 6 ou oméga 9 le sixième ou le neuvième atome de carbone qui précédent les doubles liaisons suivantes. Voir le schéma ci-dessous.
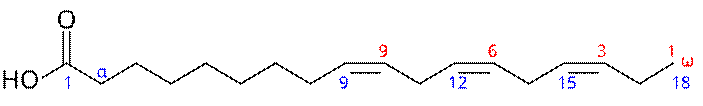
Structure moléculaire de l’acide α-linolénique (ALA).
En comptant depuis la fin, notée oméga (dernière lettre de l’alphabet grec),
la première double liaison rencontrée occupe le troisième rang, d’où le terme « oméga-3 »
Ce sont les petits chiffres de la ligne du haut. A gauche, on trouve logiquement le radical acide en « COOH ».
Par extension un peu « tirée par les cheveux », on désigne le ou les acides gras concernés par « oméga 3 » ou « oméga 6 » tout court. Comme si c’était des molécules aux vertus exemplaires. Même s’il existe plusieurs acides gras « oméga 3 ». L’expression courante dans la littérature publicitaire « riche en Oméga 3 » n’a guerre de sens. On se perd en conjecture scientifique pour vérifier qu’il doit exister un bon équilibre avec beaucoup d’oméga 3 mais trop d’oméga 6, comme le prétendent certains nutritionnistes. Après digestion, les acides gras sont tous coupés en « rondelles » d’acides gras à courte chaine, en C2, C3 ou C4, respectivement acides acétique, propionique, butyrique, pour être absorbés dans les cellules qui les utilisent comme « briques » pour la synthèse des graisses du corps humain. Les « vrais » scientifiques ont du mal à s’y retrouver dans le monde de la nutrition. Le « jargon » des oméga 3 ou 6 ressemble plus à une opération de marketing qu’à la recherche d’un appoint alimentaire sérieux pour une nutrition plus équilibrée. Trop d’oméga 6 seraient mauvais pour la santé selon certains spécialistes. Il faudrait un juste équilibre entre oméga 3 et oméga 6, ce qui supposerait d’hydrogéner des acides gras à moitié. En visant l’atome de carbone numéro 6 seulement. Mais ça, on ne sait pas faire.
Par ailleurs, nous pouvons rappeler ici que les études épidémiologiques menées en France, n’ont jamais prouvé la « toxicité » des pâtes chocolatées à tartiner, ou des barres chocolatées, consommées avec modération. La quantité d’huile de palme consommée en moyenne par leurs amateurs doit tourner autour de quelques grammes par jour, 5 grammes peut-être. C’est insignifiant par rapport à celle des autres huiles de colza, tournesol, olive ou soja avalées par personne et par jour dans notre pays. Enfin, aucun impact nocif n’a été constaté dans les pays africains où l’on consomme beaucoup d’huile de palme brute, comme la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Nigéria ou le Bénin et ceci depuis la nuit des temps. La différence entre l’huile de palme africaine et l’huile de palme de Bornéo, c’est qu’en Afrique, il n’y a pas d’orangs-outans.
6°) Les impacts écologiques
Tout y passe pour la mouvance écologique : déforestation, dégradation des sols, perte de « biodiversité », érosion, travail des femmes et des enfants, conflits de « genre », etc…. Bref, les 10 % de la surface de Bornéo couverts par des plantations d’Elaïs sont intrinsèquement pervers. A ceci près qu’une plantation de 1 000 palmiers par hectare joue exactement le même rôle qu’une forêt en termes d’érosion des sols, captage de CO2, vie de singes, etc. Leurs sols sont systématiquement semés de légumineuses tropicales fournissant l’azote dont les palmiers ont besoin et ces légumineuses protègent les sols de l’érosion. Nos lointains cousins orangs-outans raffolent des fruits de l’Elaïs et en choppent des quantités négligeables sur les arbres, ou au sol, souvent jonchés de drupes, laissées comme résidus de récolte.
Déterminer le nombre de ces singes est un défi, sachant que la partie centrale de l’île est une forêt équatoriale impénétrable et impénétrée sans aucun chemin ou route carrossable ou même piétonne. Des difficultés d’accès aggravés par l’altitude de la chaine centrale de Bornéo, qui forme une barrière Sud-Ouest/Nord-Est s’élevant en moyenne à deux mille mètres d’altitude. La ligne de partage des eaux de ce massif correspond logiquement, à la frontière entre Malaisie et Indonésie. Le comptage précis des orangs-outans de Bornéo par exploration au sol est impossible.
7°) Combien d’orangs-outans à Bornéo ?
Pour protéger ces grands singes, face à l’expansion des palmeraies, un chercheur français, Marc Ancrenaz, fondateur de l’association « Hutan » étudie le comportement de ces grands singes. Ceci à la demande du MPOC, Malaysian Palm Oil Corporation[1]. Quand ce spécialiste est arrivé à Bornéo dans les années 2010, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) avançait le chiffre de 800 orangs-outans au Sabah (Malaisie), et de 5 000 dans le monde, sans avoir fait de recensement. « Comment vouloir sauvegarder les orangs-outans si on ne sait pas combien il en reste ? » s’interroge alors Marc Ancrenaz. Il élabore donc un système unique de comptage par hélicoptère, car les orangs-outans font leur nid au sommet des arbres. Du ciel, ils deviennent plus visibles. Mais il faut que quelqu’un paie les ruineuses heures de vol en hélicoptère sur une surface supérieure à celle de l’Hexagone.
Cela dit, ce chercheur français a pu ainsi réévaluer la population de Bornéo. Il a trouvé 11 000 individus pour le Sabah (Malaisie) et environ 60 000 individus sur Kalimantan (Indonésie). Soit un total de 71 000 individus pour toute l’île. Marc Ancrenaz s’est aperçu que les orangs-outans pouvaient parfaitement vivre dans des forêts secondaires dégradées ou dans des bosquets d’arbres restés au milieu des plantations sur un pic rocheux. Un survol de Bornéo par Google Earth, que tout le monde peut faire, rend parfaitement visibles les plantations, en bandes longues, perpendiculaires aux routes, leur concentration à moins de 50 kilomètres de la mer pour d’évidentes raisons logistiques, la présence de palmiers un peu partout, en bordure de champs ou de chemins. Les « grandes » plantations sont inévitablement coupées par des délaissés rocheux ou trop pentus, d’innombrables rivières et leurs affluents, des routes de dessertes, etc. Il y a partout des « oasis » pour nos hominidés dans les plantations industrielles. Bref, en zones « palmier à huile » artisanales, diffuses ou industrielles, nos primates « non humains » sont présents partout. Et ils y vivent en parfaite harmonie avec leurs cousins humains. Comme déjà dit ci-dessus, le centre de l’île est couvert par la forêt vierge équatoriale inaccessible, mais les orangs-outans de cette forêt, dont on ignore le nombre, y sont privés de leur fruit préféré, celui de l’huile de palme. Tant pis pour eux.
[1] Source : M. Tan Sri Datuk et Dr Yusof Basiron, président général du puissant Malaysian Palm Oil Council (MPOC), association fondée par les entreprises d’huile de palme de Malaisie. Voir site internet de cette organisation

Encore une belle manœuvre du cartel écolo. C’est en manipulation et propagande qu’ils brillent.
Outang, suce pas ton bol …
Le centre de cette grande ile n’est pas pas totalement impénétrable .
Dans les années 70 les équipes du CEA l’ont fait ( j’en faisait partie ) on pouvait accéder au sommet du Bukit Raja le sommet des monts Schwaner .
Dans toutes les controverses portant sur l’huile de palme, il semble qu’on oublie la très grande quantité de CO2 captée par le palmier à huile. En effet ce végétal tire du CO2 atmosphérique l’intégralité du carbone qu’il utilise pour synthétiser les triglycérides constituant l’huile de palme. Le calcul fait à partir de la composition en acides gras donnée dans l’article (je peux fournir le calcul détaillé sur demande) montre que la production d’ 1kg d’huile de palme absorbe environ 2.8 kg de CO2 Avec les rendements de 5 à 8 t. d’huile par hectare cela conduit à une capture de 14 à 22 t. de CO2 par hectare par récolte. Et ce calcul est conservateur puisque le palmier ne synthétise pas que l’huile, mais aussi d’autres composés, et beaucoup de biomasse. La forêt primaire n’absorbe probablement pas autant de CO2.